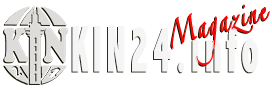L’annonce de la mort inopinée du célèbre écrivain et philosophe congolais, le professeur Valentin-Yves Mudimbe suscite des réactions allant d’hommages sobres à l’égard de ce grand romancier. Le récent hommage enflammé est celui fait par le Directeur général du Centre culturel et artistique pour les pays de l’Afrique Centrale, Balufu Bakupa-Kanyinda. Ce dernier en sa qualité de cinéaste, écrivain et maitre des Arts n’est pas resté indifférent dans un témoignage d’éloge funèbre rendu public ce jeudi 24 avril 2025. Il célèbre l’un des grands intellectuels du congo dont il a côtoyé à plusieurs reprises. Ci-dessous le témoignage d’éloge funèbre.
Hommage au Professeur Valentin-Yves Mudimbe (1941-2025)
L’architecte de la pensée africaine contemporaine
Balufu Bakupa-Kanyinda
L’air pèse sur Lubumbashi, ce jour-là, lourd de chaleur et de silence. Une chaleur de plomb s’abat sur le Centre culturel français où je commence ma vie professionnelle comme animateur, entre des piles de livres, où flotte l’odeur d’un café brûlé. C’est là, précisément là, que son nom me frappe pour la première fois, avec la force d’une révélation.
— « Mudimbe a quitté le Zaïre ! Mudimbe est parti en exil ! »
Les voix se font chuchotements, fragments d’échos, cognant contre les murs frais du centre. A l’époque de Mobutu, on n’élève pas la voix. Novembre 1979. Je viens d’arriver à Lubumbashi. Un tournant s’annonce dans ma vie encore modeste. Le pays suffoque sous la poigne du régime, et voici que son esprit le plus éclatant choisit l’exil. Entre mes mains tremblantes, je tiens un exemplaire du Bel immonde – ma première rencontre avec ce géant qui, désormais, hantera mes jours de réflexion.
Qui aurait su deviner ? Ce fils du Congo, né à Likasi, au Katanga, en 1941, formé par les Bénédictins, ce philosophe semblable à un moine défroqué, s’élèvera jusqu’à devenir l’architecte d’une pensée africaine nouvelle. Son itinéraire a la fulgurance d’un roman : le noviciat qu’il abandonne à 21 ans, l’Université de Kinshasa, puis celles de Paris et de Louvain, dans les brumes humides de Belgique, le retour pour enseigner à Lubumbashi, et ce départ précipité, droit vers l’exil, vers Stanford, Haverford, Duke… L’Amérique façonnera ce savant à double identité intellectuelle, romancier francophone, théoricien anglophone.
« V.Y. » – ces deux lettres que nous murmurons à l’anglaise, « Vee Why », comme une question suspendue. Ou bien « Hermano Matteo », ce nom énigmatique, vestige peut-être d’années passées au couvent. Jamais je n’ose lui demander. Certains mystères valent le respect.
Je le croise dans ces villes où la pensée africaine se cherche et se forge. À New York d’abord, silhouette discrète et lumineuse, « Academic Star » malgré lui, souriant à sa propre renommée. Ses séminaires à Duke, veillées sacrées où chaque silence pèse, où chaque regard ouvre un abîme de sens.
À Paris, ensuite. Nos marches lentes entre Beaubourg et le Marais s’inscrivent en moi comme des souvenirs gravés dans la pierre. Il marche, déposant son pas avec une lenteur volontaire, absorbant les pavés, imprégnant les rues de sa présence. Dans ces ruelles où l’art survit entre deux librairies, il évoque ses jeunes années, ses premiers combats, ses doutes.
— « Prends ton café noir, Balufu, comme un vrai Congolais », sourit-il, assis dans ce bistrot modeste qui nous abrite.
Bruxelles enfin. Matonge, un soir d’après conférence. Je suis venu de Paris pour l’écouter. Ce restaurant congolais où personne ne le reconnaît, lui, l’homme qui bouleverse notre vision du monde. Il rit, ce soir-là, de ce rire clair et lointain :
— « La gloire est un fantôme qui ne hante que les bibliothèques. »
Une leçon d’humilité, simple et éclatante.
Puis Nairobi, août 2003. L’air y est chargé de promesses, d’ombres menaçantes. Ngũgĩ wa Thiong’o vient de rentrer après vingt-deux ans d’exil, et déjà plane la peur. Je me vois encore, assis au Hilton, sur ces fauteuils de cuir fatigué, retraçant pour V.Y. l’indicible : l’attaque du Norfolk, les brûlures sur la peau de Ngũgĩ, le viol de Njeeri.
Ngũgĩ wa Thiong’o revient au Kenya. Son ami, le Professeur Manthia Diawara, décide de filmer ce retour. Je suis appelé à produire ce film. Nous posons nos bagages à Nairobi, début août. Ngũgĩ, Njeeri, leurs plus jeunes enfants descendent à Jomo Kenyatta Airport, acclamés par des milliers de voix. Le tournage s’ouvre sur l’espoir. Nous le suivons, de Limuru à Kampala, vers ses lieux de mémoire. Mais le 11 août, l’espoir se fracasse. Une agression, brutale, dans leur résidence de Norfolk Apartments. Le film change. Il devient une enquête. Qui a peur de Ngũgĩ ? Qui craint les penseurs libres ?
Dans le bar anglais de Hilton, à Nairobi, je raconte. Mudimbe écoute, les doigts autour d’un verre de whisky. Ses yeux brillent d’une intensité troublante.
— « Tu vois, Balufu, nos vies se reflètent : l’exil, les livres comme armes, et ces mains sales qui étouffent la lumière. »
Quelques jours plus tard, je les vois, Ngũgĩ et lui, en dialogue. Le guerrier des langues africaines et l’archéologue des savoirs dominés. Leurs paroles claquent comme des drapeaux.
— « La bibliothèque coloniale brûle, page après page », murmure V.Y. alors que les lucioles, autour de nous, sont des étincelles de révolte.
À Kinshasa aussi, je l’aperçois, fugace, trop peu.
Et maintenant qu’il rejoint les ancêtres, je me souviens de ses mots, quittant ce restaurant anonyme de Bruxelles :
— « Ce qui compte, ce n’est pas qui nous connaît, mais ce que nous semons dans l’invisible. »
Il avait vu juste. Regardez autour de vous : dans chaque livre, chaque pensée libre, chaque jeune esprit qui questionne, les semences de Mudimbe grandissent. La bibliothèque coloniale se consume encore. Et nous, nous gardons vivante cette flamme.
Aujourd’hui, la nouvelle de sa mort me traverse. Mudimbe n’est plus. Mais regardez : ses livres s’ouvrent encore, lucarnes vers une Afrique retrouvée. Ses mots, vivants, dansent dans les salles de classe, les amphithéâtres, les cercles de pensée.
« La vraie mort est l’oubli des idées qui ont changé le monde », écrit-il dans Les Corps glorieux. Par ces mots, il s’offre l’éternité. Comment oublier celui qui nous apprit à désapprendre ? Comment refermer le livre de celui qui réécrivit toutes nos histoires ?
La nuit descend sur Kinshasa. Quelque part, dans une bibliothèque, un étudiant ouvre L’Odeur du père. Et soudain, Mudimbe est là. Présent. Indélébile.
Reposez en paix, maître. Votre bibliothèque africaine reste grande ouverte pour les siècles à venir.
Balufu Bakupa-Kanyinda
Cinéaste, Écrivain, Enseignant, Maître des Arts.
Directeur général du Centre culturel et artistique pour les pays de l’Afrique centrale (CCAPAC).
Kinshasa, le 23 avril 2025